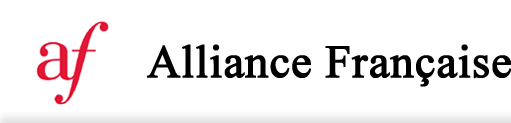|
|
|

Préface
Afin de fêter le 90ème (ou 140ème) anniversaire
de notre Alliance, nous voulions faire partager notre émotion
à la découverte de nos archives. C’est pourquoi,
nous avons décidé de concevoir une brochure qui
relate une partie de l’histoire de l’Alliance Française
de Saint-Gall, de ses débuts jusqu’à l’année
1956. Nous poursuivrons notre recherche jusqu’à
nos jours en vue du 100ème anniversaire.
Ce résumé a été écrit à
deux mains, une suisse-alémanique et l’autre franco-suisse
pour exprimer la réalité encore actuelle de notre
société. Il est présenté en version
bilingue pour permettre à tous d’y avoir accès
sans difficulté.
Ce travail a été rendu possible grâce au
soutien du Service Culturel de l’Ambassade de France,
dont nous tenons à remercier son Conseiller M. Alain
Sauval.
Nos remerciements vont aussi à Mme Amélie Pianca
et M. David Zaugg pour leur important travail de recherche et
de traduction. Un merci particulier à Mme et M. Odile
et Reto Steurer, ainsi qu’à Mme Véronique
Paky et M. Hans Wolfgang Hunkel, pour l’aide apportée
à la mise en forme de ce document.
Nous espérons partager avec vous notre plaisir à
découvrir l’Histoire de notre Alliance.
Saint-Gall, novembre 2002
La Présidente
Dominique Andermatt-Gindrat

De la Société «Sprach-
und Unterhaltungsverein» à la «Société
Française»
| Le 3 octobre 1862, onze Saint-Gallois, ayant tous passé
une ou deux années en France ou en Suisse romande, se
réunissent pour fonder l’association dite «Sprach-
und Unterhaltungs-Verein» ou société
de langue et de divertissement. L'objectif premier est
l’exercice de la langue française ainsi que le
perfectionnement en conversation, en langue écrite et
en grammaire, sans y négliger le plaisir, comme nous
le verrons plus loin. |
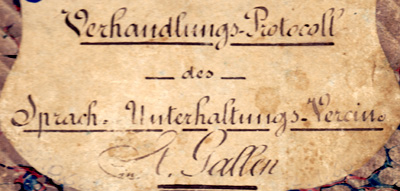 |
| On se donne même des devoirs pour
la prochaine réunion, comme par exemple apprendre à
conjuguer des verbes. Les premiers procès-verbaux des
réunions sont rédigés en allemand dans
une écriture aussi belle à contempler que difficile
à déchiffrer parce qu'écrite en vieil allemand.
Les comptes, les rapports et les statuts sont des oeuvres d'art
calligraphique environ jusqu’en 1900. |
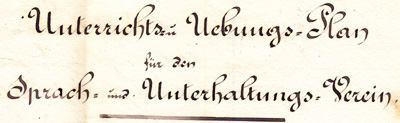 |
On se rencontre une fois par semaine pour étudier et
discuter; on tient des assemblées mensuelles et deux
assemblées générales par année.
Elles sont obligatoires. La cotisation s'élève
à 20 centimes par membre et par semaine ce qui,
toute proportion gardée, ne représente pas
une bagatelle. Le comité directeur comprend un président,
un vice-président et un secrétaire-caissier qui
fonctionne aussi comme bibliothécaire, car dès
le début, on monte une bibliothèque.
La société se réunit dans une salle qui
lui est généreusement mise à disposition
au premier étage du restaurant «Zum Grünen
Baum» au Bohl, «sans être obligé de
payer la lumière», note-t-on. Avant chaque réunion
on fait l’appel et les absences injustifiées sont
sanctionnées de 20 centimes. Ainsi le 3 novembre
1862 on relève que le président Schneider, MM.
Schlegel, Weber et Kieni arrivent en retard à la séance
(ce qui n’est pas imputable aux problèmes de stationnement
!).
L’association forte de 15 membres «tient bon la
barre» six mois, poursuit son objectif avec succès
et change de nom en mars 1863 et devient la «Société
Française».
| Manifestement, les heures de l'apprentissage ont porté
leurs fruits, car les procès-verbaux, les rapports, les
statuts et comptes-rendus sont dorénavant rédigés
en français. On encourage la lecture par des abonnements
à des journaux (Le journal de Genève, Pour Tous),
l’achat de livres, de dictionnaires et de grammaires en
français. La bibliothèque qui comprend 87 volumes
en 1864, se trouve dans le local de réunion dans une
armoire fermée à clef. On cherche maintenant un
enseignant de français pour diriger les heures d’étude. |
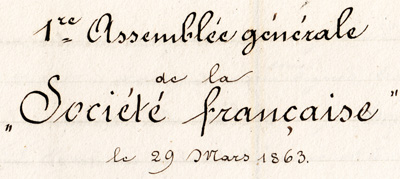 |
A chaque assemblée mensuelle on décide de l'admission
ou non de nouveaux membres. Il faut montrer patte blanche pour
être accepté, cependant bien des métiers
sont représentés : employés de poste, chef
télégraphiste, chef de gare etc. et la variété
s’enrichit constamment avec l’augmentation du nombre
des membres. Les présidents changent environ tous les
six mois jusqu’en 1883; nous trouvons des noms comme Tagmann,
Leuzinger, Rieder, Gaudin, Tobler, Winterhalter. Parce que la
bibliothèque représente une trop grosse charge
pour le secrétaire-caissier Schlegel, un bibliothécaire
est nommé spécialement en 1864. La composition
des statuts est maintenant terminée et approuvée
à l'assemblée générale de février
1866 et signée par 78 sociétaires. Des organisations
semblables voient le jour à Flawil, Ebnat-Kappel, Rheineck,
Gossau, Buetschwil, Rorschach et Berneck, et on cherche
le contact. On n’hésite pas, en 1866, à
rayer (avec treize voix contre une) le membre fondateur et ancien
président Schneider de la liste des membres pour ne pas
avoir payé ses cotisations malgré les sommations
du caissier. Ces années sont l’apogée de
la société au 19ème siècle car elle
verra le nombre de ses membres diminuer au cours des années
suivantes.
Des excursions font également partie de la vie d'association;
on organise la première promenade à Voegelinsegg.
D’autre part, les problèmes habituels auxquels
une association doit faire face ne tardent pas à émerger.
L’absentéisme commence à sévir malgré
les amendes, la bibliothèque est délaissée,
le local est trop petit ou trop humide, le service du restaurant
est insatisfaisant, le caissier doit sommer les membres de payer
leurs cotisations, des membres partent sans donner leur
démission...
Faut-il placer une annonce dans le journal pour attirer de nouveaux
membres et réveiller l’intérêt des
membres actuels ? Pour chaque réunion, on prévoit
à l’avance la discussion d’un thème.
Ce sont des thèmes comme par exemple «le décès
de l'empereur Maximilien du Mexique», ce qui soulève
aussi la question de savoir si l’on peut parler politique
dans ces réunions. Les convocations aux réunions
sont publiées gratuitement dans le «St. Galler
Tagblatt» par Monsieur Zollikofer.
Cette année, on verse Fr. 50.- à des victimes
d’incendie. On accorde Fr. 20.- à la bibliothèque
pour l'acquisition des oeuvres d’Eugène Sue qui
lui manquent. On accorde un subside au groupe de chant de la
société. Faute de membres, celui-ci trouve bientôt
«la paix éternelle» selon les notes du secrétaire.
Le groupe d’enseignement en revanche tient bien le coup.
Le président Tagmann écrit : «Les leçons
de grammaire ont été fréquentées
pendant cette dernière période par 6 à
7 membres et dirigées par notre infatigable commissaire
de police M. Schlegel, auquel nous donnons nos vifs remerciements».
L'assemblée générale décide d’admettre
provisoirement les étrangers, mais on les rejettera
deux ans plus tard. De même, on exclut un membre parce
qu’il a fait faillite et compromet par ce fait «l’honneur
de la société».
Les cours de français sont maintenant donnés par
le Professeur Rieder qui deviendra bientôt Président
de la Société. Pour animer les réunions,
on propose des jeux : échecs, cartes, rami ou jass. Ce
dernier sévira bientôt au grand dam de ceux qui
ne s'y intéressent pas. On crée des «réunions
ambulantes», c’est-à-dire qu’on se
réunit deux fois par mois ailleurs que dans le restaurant
habituel. On organise une soirée de carnaval pour la
gaieté, auquel cas le protocole ne précise pas
si les femmes pouvaient s’y rendre déguisées
en hommes. En effet, il faut savoir que la «Société
Française» est une société masculine,
les femmes n’étant pas admises. En revanche on
acceptera, après d’âpres discussions,
un élève de 17 ans de la «Kantonsschule».
Dans ce temps, le comité prend l’habitude peu à
peu de se réunir chez le Président, M. Tobler.
Mme Tobler s’offre gracieusement pour servir à
boire à ces messieurs. Les dames travaillent donc en
coulisses.
Dans les années soixante-dix, les membres de l'association
se recrutent parmi les professions de chapelier, commis, tailleur,
confiseur, horloger, brodeur, imprimeur, photographe, libraire,
avocat, professeur, pasteur, et même un conseiller d'état
y participe. A l’époque, l’association est
abonnée aux journaux et revues suivants : L'Illustration,
Paris Caprice, Le Magasin Pittoresque, Le Journal pour rire,
Le Journal Illustré, L'Education et l'Instruction, Le
Globe Illustré et La Patrie Suisse. Les sociétaires
peuvent les lire au local avant leur mise en circulation dans
des porte-cahiers.
Vers 1882, on organise une excursion avec concours de tir à
la cible ou au flobert. Chaque année on prévoit
en automne également un «Sauserfahrt» (promenade
de dégustation du moût) qui fait problème:
en effet, si la course d’automne se fait trop tôt,
le moût n’est pas prêt et si l’on attend
qu’il soit tiré, il y a peu de participants car
tout le monde a repris ses occupations et les jours raccourcissent.
On descend donc à Rorschach, Risegg, Buchberg, Thal,
Rheineck, on fait beaucoup de marche à pied et l’on
mérite ainsi son moût lors de plusieurs haltes
de dégustation. On remonte sur Saint-Gall, content et
rassasié, après avoir levé son verre tant
de fois à la santé de la Suisse, de la France
et de la Société Française.
Peu à peu, malgré toutes ces intéressantes
manifestations, le nombre des membres de la société
diminue. De 78 qu’ils étaient en 1866, il n’en
reste plus que 26 en 1888. La bibliothèque doit quitter
le Musée qui a besoin de place. On ne parle plus de leçons
de grammaire et de langue, mais pour attirer de nouveaux membres
et favoriser la participation, on voudrait que chaque sociétaire
veuille bien préparer une causerie sur un sujet qui l’intéresse
pour animer un peu la conversation. Les assemblées trimestrielles
se passent en présence de 8 à 10 membres, et les
séances du comité sont expéditives. Lors
de la préparation d'une excursion en juillet 1883, un
membre avait déjà proposé d'y inviter les
dames, on avait voté, la majorité était
contre.
Vers la fin du siècle, il y a des différends entre
les traditionalistes et les rénovateurs de l’association.
Grâce à la conduite équilibrée du
Président, M. Scheitlin, l’association est sauvegardée.
À la fête du 30ème anniversaire de la «Société»
à Weissbad, il n’y a que 8 participants. On décide
de réduire le comité à 3 personnes et de
ne se réunir que deux fois par mois, mais la participation
des femmes n’entre pas en question.
La fondation du «Cercle Français de Bienfaisance» (1878-1935)
Laissons donc là pour un moment la «Société
Française» et tournons notre attention vers une
autre association qui est fondée à Saint-Gall
en 1878 : Le «Cercle Français de Bienfaisance»
qui au départ compte cinq membres très français
venant de Nîmes, de Paris, de St-Quentin et de Belfort,
tous résidant à Saint-Gall et qui se réunissent
sous les mots d’ordre «patriotisme» et «philanthropie».
Ici, nous vivons l'histoire de la France encore de plus près
que dans la «Société Française».
|
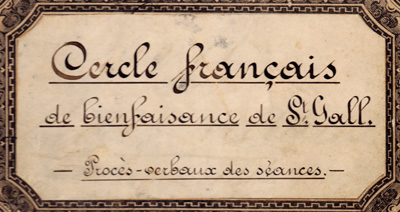 |
Voici une
citation du Président à la réunion de la
fondation:
«Les changements résultant de la guerre de 1870
ont amené dans la ville de Saint-Gall un plus grand
nombre de Français cherchant du travail et demandant
des secours à leurs compatriotes résidents.
Aussi la formation d’une association française
à but humanitaire nous avait-elle déjà
préoccupés et avait été le sujet
de plusieurs entretiens avec M. Moutarde, un de nos membres
actuels : toujours, nous avons hésité en raison
du petit nombre de Français réunis à
Saint-Gall, nous contentant en diverses occasions de nous
concerter pour rendre nos secours plus efficaces».
Vu le petit nombre de Français inscrits, on décide
d’accepter également des Suisses-romands ou même
des étrangers qui sont d’accord avec les principes
et les statuts de la société. On élit
de généreux membres donateurs habitant à
Lyon, Nantes et Paris «membres honoraires», on
accepte des membres passifs qui habitent trop loin pour assister
aux réunions.
Le nombre des membres actifs progresse régulièrement.
On rassemble de vieux vêtements pour les distribuer
aux nécessiteux de passage à Saint-Gall. Les
réunions ont lieu une fois par semaine. Ici aussi,
il y a des assemblées générales
obligatoires avec appel, cotisations, lectures des procès-verbaux
et de la correspondance, discussions des nouveaux statuts,
acceptation de nouveaux membres parrainés par des anciens.
On trouve un local au Loechlibad avec un piano, ce qui
est important car il y a des mélomanes.
En 1879, le «Cercle Français de Bienfaisance» compte
21 membres actifs et 8 honoraires, il a secouru 29 personnes
en un an pour Fr. 225.40 et on dépose un actif de Fr.
450.- à la Creditanstalt. On décide de faire
rénover le monument de St-Fiden érigé
en l’honneur des internés français morts
à Saint-Gall (les Bourbaki) en 1871 et d’y
déposer régulièrement une couronne. Voici
un extrait du discours de Monsieur C. Laroche, du membre du
«Cercle Français de Bienfaisance» et directeur des broderies
mécaniques à Flawil, prononcé à
l’occasion de cette rénovation :
«Messieurs, chers compatriotes,
En 1870/71, je faisais partie de cette désastreuse
campagne qui s’est terminée par la perte de deux
des plus belles provinces françaises. Comme les soldats
qui reposent sous cette terre, et en mémoire desquels
nous sommes réunis ici, j’étais de cette
malheureuse armée des ... Bourbaki qu’un sort
funeste contraignit de chercher un refuge sur le sol hospitalier
de la Suisse ; mais, plus heureux qu’eux, j’eus
le bonheur de revoir la patrie, déchirée alors,
relevée aujourd’hui, toujours notre belle France.
Des circonstances douloureuses ont obligé quelques-uns
d’entre nous à quitter la mère patrie
pour en choisir une nouvelle ; des motifs tout différents,
soit d’intérêt commercial, soit d’intérêt
privé, ont éloigné momentanément
les autres du sol natal. Ces causes diverses nous ont accidentellement
réunis à Saint-Gall, mais notre coeur à
tous est resté français. Aussi, si jamais l’heure
du danger revenait, si la patrie menacée faisait appel
à ses enfants, inspirons-nous de l’exemple des
infortunés qui sont couchés ici, et si tous,
nous ne pouvons pas voler à sa défense, tous,
au moins, contribuons à lui venir en aide, chacun selon
la mesure de ses moyens.»
Encore un autre passage d’un discours de M. Lévy,
prononcé lors du dépôt de couronne le
14 juillet 1881, pour faire ressentir tout le poids de l’histoire
:
«Hélas ! Pourquoi faut-il qu’à
ces pures joies patriotiques la tristesse et les regrets viennent
mêler leur amertume ? Défendrez vous, Messieurs,
à un Alsacien, de se souvenir, non sans un serrement
de coeur, qu’il est des villes, des campagnes profondément
attachées à la France, qui ne pourront célébrer
qu’en secret cette fête nationale ? Mais nous
avons d’autres motifs encore de comprimer les élans
de notre joie et de demeurer tristes et graves en ce jour.
Ici, sous l’herbe que nous foulons, sont couchés
nos frères, héros obscurs, les plus infortunés
peut-être de tous ceux qu’a produits la sanglante
tragédie de 1879. Ils n’ont pas eu la consolation
de tomber glorieusement comme les autres au champ d’honneur,
fortifiés par la pensée qu’en sacrifiant
leur vie, ils sauvaient la partie, ils ont souffert au fond
d’un hôpital une longue et douloureuse agonie,
ils ont vécu assez hélas ! pour voir la France
vaincue, humiliée, envahie ; ils sont morts de découragement
dans l’âme, désespérant de la patrie,
ne sentant que trop bien que leur sacrifice de tant de belles
et jeunes existences s’opérait en pure perte.»
En 1879 déjà, le «Cercle» compte suffisamment
de membres et renonce dorénavant à accepter
des étrangers. On continue à aider des nécessiteux,
on paie le train aux Français de passage qui cherchent
à s’installer en Suisse, on verse des subsides
aux victimes de catastrophe (à Elm, Glaris 1882). On
accepte comme membre un ouvrier-forgeron qui a trouvé
du travail ainsi qu’un M. Traber car il a donné
des preuves de la solidité de son caractère...
Une grave question tourmente le «Cercle» : faut-il soutenir
les déserteurs ? A part cela, la vie de société
du «Cercle Français de Bienfaisance» ressemble beaucoup
à celle de toute autre association : excursions,
banquets, anniversaires, discussions pour les modifications
de statuts ou changements de locaux. Toutefois des questions
plus exceptionnelles sont aussi discutées : faut-il
fêter le 14 juillet alors qu’une épidémie
de choléra sévit dans le midi de la France en
1884 ? On se décide pour un oui. Faut-il se fédérer
aux autres «Cercles Français» de la Suisse ? On réserve
cette option pour plus tard.
En 1890, on accepte un membre féminin en la personne
de la fille de M. Charmey, un membre masculin qui vient de
décéder. Est-ce l’influence française
qui se répercute ou plutôt la crainte d’une
diminution des membres qui deviendra effective pendant les
années quatre-vingt-dix comme c’est le cas, d’ailleurs,
dans la «Société Française»
? Cette année, on renonce à la grande promenade
d'automne, pour en octroyer les frais qu’elle occasionnerait
à M. Moutarde, ancien président, qui est malade
et dans une situation financière pitoyable. On remarque
souvent, à cette époque, des cas semblables
: les préoccupations financières peuvent rendre
malade, ou alors la maladie, avec les frais médicaux
et hospitaliers, peut entraîner très vite une
situation financière difficile.
Ici, l'appartenance au «Cercle» peut apporter du soulagement
: on alloue Fr. 100.- à M. Moutarde alors que
les Alsaciens et Lorrains de passage à Saint-Gall et
qui se trouvent en difficulté reçoivent
Fr. 2.- ou 3.- et ils ne sont pas moins de 81 cette année
à avoir été secourus.
Vers 1890, la situation économique difficile est à
l’origine de démissions et de départs.
Même M. C. Laroche, ancien président de l'association
et directeur des broderies mécaniques de Flawil déménage.
On entretient encore les tombes de St-Fiden, mais en 1894
on se demande si le «Cercle» va pouvoir continuer. On se réunit
de moins en moins, il ne reste que quelques rapports de caisse
et, ensuite, plus aucune trace de réunion jusqu’en
1918. Nous constatons que les deux associations, le «Cercle
Français de Bienfaisance» et la «Société
Française» ne semblent entretenir aucune relation et
ne se mentionnent pas dans leurs archives respectives.
| Pour le «Cercle Français de Bienfaisance», tout reprend
en 1918. Un télégramme est envoyé à
Georges Clemenceau «Libérateur du Territoire»,
qui répondra par l'Ambassadeur de France en Suisse.
On cherche et trouve un nouveau local auprès du «Kaufmännischen
Verein», on achète des meubles et on accepte
sept nouveaux membres féminins (!). On fait modifier
les statuts par le Consul de France à Zurich, ce qui
apporte certains avantages à la société.
On reçoit l'ambassadeur français en Suisse et
on le fait s’inscrire dans le livre d'or de l’association. Les activités reprennent : la gerbe ou la couronne
sur la tombe des Bourbaki, le banquet du 14 juillet etc. On
commence avec 21 membres actifs, bientôt on est déjà
28, c’est le moment de faire venir un photographe. On
organise des «goûters assaisonnés de gaieté»
et on y invite - deux délégués de la
«Société Française» devenue
entre-temps «l’Alliance Française de Saint-Gall».
On décide alors de poursuivre les échanges. |
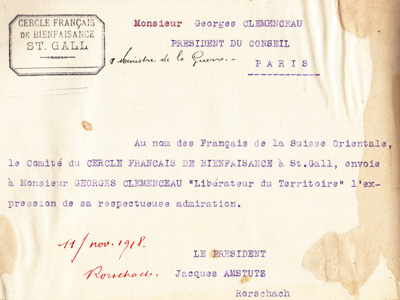 |
En rapport avec un chargé de mission du gouvernement
Français à Berne, on décide de collaborer
à l’organisation de tournées de conférences
de célébrités françaises en Suisse.
Mais ces beaux projets de conférences sont battus en
brèche par l’épidémie de grippe
de 1918. A la place, on alloue l’année suivante
un subside de Fr. 500.- à la crèche de Saint-Gall.
En 1921, le «Cercle» compte 59 membres actifs et «le»
secrétaire rédigeant les procès-verbaux
de jadis est devenu «la secrétaire». On
organise des soirées avec de petites conférences
culturelles avec pour thèmes «Mme de Staël»,
«Maupassant», «la diction», «les
avantages de la laideur», «les moeurs à
la cour de Henri II», et des petites productions terminent
les soirées : piano, récitation de poèmes,
charades, jeux de société, on chante également,
car on possède un recueil. Une fois, on organise même
un concours de récitation avec un jury et des prix.
Puis, en 1925, toutes les activités de ce cercle dynamique
cessent d’un coup. La cause en est cette fois-ci une
raison interne: Le pasteur Herminjard de l’Eglise Française,
président talentueux et polyvalent, est décédé
subitement. Le professeur Charles Siegfried qui siège
d’ailleurs au comité des deux associations, lui
succède mais renonce quelques mois plus tard à
cette fonction pour des raisons de surmenage. Tout prend fin
à l'exception de la comptabilité qui effectue
encore jusqu’à 1935 quelques paiements aux jardiniers
Ruedlinger et Buecheler pour les soins du tombeau français
(les tombeaux Bourbaki ont entre-temps été mis
ensemble en une seule tombe) et verse des subsides à
quelques anciens de la Légion étrangère
de Sidi bel Abbès et de la Syrie, MM Widmer, Weik,
Finsterl, Schoch et Dupertuis, ainsi que Fr. 20.- pour deux
Français qui font un tour du monde à pied. Les
archives du «Cercle Français de Bienfaisance» sont jointes
à celles de l’«Alliance Française de Saint-Gall».
Déjà depuis une bonne douzaine d’années
on observe des affiliations doubles. Ainsi les deux associations
se sont réunies en quelque sorte, même si nous
n’avons pas connaissance d’actes de fusion officielle.
La «Société Française» devient «l’Alliance Française de Saint-Gall»
Reprenons donc, si vous le voulez bien, la «Société
Française» qui battait de l’aile en 1900 avec
des tensions entre réformistes et rénovateurs.
Lors d’une manifestation en 1911 on n‘enregistre
plus que 11 membres présents. Heureusement que les
séances du comité sont divisées en deux
parties : la séance de travail proprement dite, et
la deuxième partie récréative. Le secrétaire
de l’époque note:
«Il est 10.30 h lorsque la seconde partie commence.
Les bouchons sautent, le vin mousse au fond des verres et
bientôt quelques bouteilles de Neuchâtel blanc
sont vides : ce bon petit vin délie toutes les langues
et met tout le monde de bonne humeur. M. Keel (le Président)
chanta en trois langues au plus grand plaisir des assistants
et le secrétaire récita deux monologues
comiques. Il était minuit et demie lorsque nous vidâmes
notre dernier verre à la prospérité de
la «Société Française» en général
et à la santé de chacun de ses membres en particulier.»
En 1907, on voudrait bien accepter «quelques jeunes
gens qui par leur intelligence et leur caractère se
prêteraient au but de la société».
C’est l’état d’esprit de l’époque
: on veut bien rajeunir la société, mais ce
sont les jeunes qui doivent s’adapter à elle.
C’est le marasme et on se console avec le Grand «Pocal»
d’Honneur qu’on remplit de bon vin vaudois ou
de «Neuchâtel», en 2ème partie...
Vers 1910, on organise des «soirées familières»
où les épouses peuvent venir et où les
célibataires peuvent même amener leurs bonnes-amies.
Est-ce grâce à ces mesures libérales qu’un
an plus tard 12 nouveaux membres s’inscrivent ? C’est
une aubaine assurant la subsistance de la société
pour un certain temps, car il ne restait plus que 11 membres.
A partir de là, les «gracieuses épouses»
peuvent aussi participer quelquefois aux excursions.
Un nouveau membre en la personne du pasteur Herminjard (qu’on
connaît aussi dans le «Cercle Français de Bienfaisance»)
s’investira en 1913 encore explicitement pour l’admission
des femmes. Mais elles ne seront acceptées en tant
que membres de la société que six ans plus tard.
En 1912, on se met en rapport avec l’«Alliance
Française de Zurich», puis avec l’institution
respective de Paris, et on commence à parler de conférences
culturelles. 1912 est aussi l’année du cinquantenaire
de la «Société Française» qui prend maintenant
à son tour le titre d’«Alliance Française
de Saint-Gall». C’est assez remarquable que
cette société composée d’une majorité
de Suisses-allemands soit devenue l’«Alliance Française
de Saint-Gall» et que ce ne soit pas le «Cercle Français
de Bienfaisance» qui ait amorcé cette métamorphose
ou même que les deux sociétés n’aient
pas fusionné dans ce but.
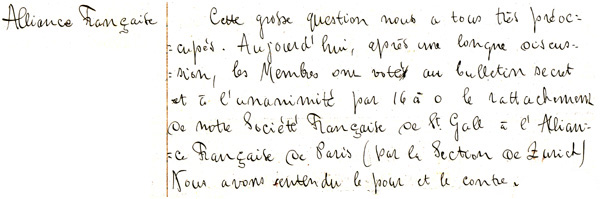 |
Assemblée extraordinaire le 10 décembre 1912
au local «Schlössli» |
En 1913, par l’intermédiaire de l’Alliance
Française de Zurich, on invite M. Henry Welschinger
de Paris, membre de l’Institut de France, à présenter
une conférence sur le «Comte de Mirabeau».
A part cela, des membres ou des personnes de leur entourage
donnent des conférences sur un pays ou des sujets qu’ils
connaissent.
En 1915, on fixe une excursion au 9 mai car le 10 est une
date de mobilisation qui concerne plusieurs membres dont le
bibliothécaire qui doit être remplacé.
On s’abonne à «L’Histoire de la Guerre».
Ce n’est qu’après la Première guerre
mondiale, en 1919, que les femmes seront admises comme membres
de l’Alliance Française de Saint-Gall. Citation
lue dans un procès-verbal : le Président relève
que, depuis l’admission de membres féminins,
le comité est stimulé à organiser des
parties de plaisir.
A partir des années 20, l’Alliance Française
de Saint-Gall est soutenue par Paris aussi bien sur le plan
financier qu’avec des livres. La société
maintient sa vitalité avec de nouvelles idées.
Une «Commission de plaisir», dirigée par
la jeune Mlle Justrich, se charge de l’organisation
de certaines manifestations de caractère plaisant.
Il faut dire qu’à l’époque (fin
des années 20, début des années 30) la
grande soirée annuelle avec comédies jouées
par les membres, bal, tombola et de belles toilettes attirent
de 180 à 200 personnes.
Mais en 1933, la situation change : sans doute une conséquence
de la crise qui sévit depuis 1931, on enregistre des
démissions. La grande soirée est supprimée
puisqu’elle occasionne trop de frais. C’est la
reprise de la flamme en 1936. Mlle Justrich constate par sa
réélection à l’unanimité
à la tête de la commission de plaisir «combien
ses talents sont appréciés».
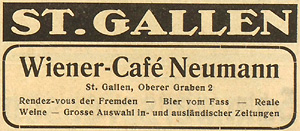 |
En 1939 on se voit contraint de changer de local, «en raison de la conduite par trop bruyante de quelques jeunes éléments», l’Alliance n’est plus la bienvenue au Café Neumann, la commission de plaisir a trop bien fonctionné ! Où mettre la bibliothèque qui prend considérablement de place ? On parle du «Hecht», mais elle ira au «Walhalla». |
On commence à faire des excursions en auto comme plusieurs membres en ont une, et on visite le château d’Arenenberg.
Puis c’est la Guerre et toute activité est interrompue.
On recommence en 1945. M. Beausire est élu Président,
Mme Reiner vice-présidente, M. Grellet reste fidèle
à son poste de bibliothécaire. On devient plus
sobre dans les divertissements, mais dans la deuxième
moitié des années quarante, on réussit
à organiser quelques conférences d’envergure
: «Les Etats-Unis» 1946 par André Maurois,
«Avec la colonne Leclerc du Tchad à Tripoli»,
début 1947 par le Général Ingold (au
Cinéma Palace avec des billets d’entré
de Fr. 1.75 à 3.30). En 1948, le Général
Giraud raconte sa dernière évasion, et De Lattre
de Tassigny, reçu en grandes pompes par l’Alliance
et les autorités de la ville, parle de «l’Epopée
de la première Armée Française».
|
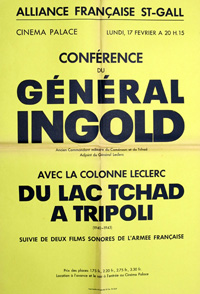 |
À partir de 1951, les conférences se succèdent
régulièrement, parcimonieusement, selon les
moyens de la société : il y en a cinq en 1951,
deux et la projection d’un film sur André Gide
en 1952, et deux conférences en 1953. A cette époque
comme aussi plus tard de temps à autre, on déplore
le fait que malgré toutes les communications et invitations
respectives, la presse ne prend guère le relais de
toutes ces manifestations de l’«Alliance Française».
L’Alliance manquant de conférenciers de Paris
en 1954, des conférences sont présentées
par le président M. Beausire qui parle de Paul Eluard,
de Mme Haller et de Julien Green et le vice-président
M. Plattner de la malaria.
À partir de la même année, on mentionne
le «Thé des dames», réunion de femmes
de deux après-midis par mois au «Walhalla». Le cimetière
de St-Fiden est supprimé depuis 1955, et en 1956 le
«Walhalla» est dévasté par un incendie. L’Alliance
doit se trouver un nouveau lieu de réunion et déménagera
à l’hôtel «Hecht».
Ici, nous cessons nos notes, l'histoire étant un éternel
recommencement, et nous rejoignons une époque dont
beaucoup de Saint-Gallois vivants portent le souvenir en eux,
et bien des membres âgés de l’«Alliance
Française» auront eux-mêmes vécu l’histoire
de la société à partir de ce temps.
Amélie Pianca, David Zaug
|
|
|